« Le syndicalisme dans la doctrine sociale de l’Église catholique », par Jean-Yves Naudet


par Jean-Yves Naudet, Professeur d’économie (1).
Cet article a été publié le 8 septembre 2009 par l’Association Internationale pour l’Enseignement Social Chrétien
Au sens strict du terme, la doctrine sociale de l’Église, telle qu’elle est exprimée au plus haut niveau par le magistère romain, commence avec la parution de Rerum novarum, de Léon XIII, en 1891. Bien entendu, en particulier tout au long du XIX° siècle, de nombreux laïcs avaient déjà développé une pensée et une pratique du catholicisme social, à commencer par Frédéric Ozanam, ou, plus tard, Albert de Mun et René de La Tour du Pin. Des prêtres, puis des évêques, et notamment en Allemagne monseigneur Ketteler, avaient également pris des positions claires en ce domaine. Ici même, en Suisse, et particulièrement à Genève, comment ne pas évoquer la figure de monseigneur Mermillod, évêque de Lausanne et de Genève, créé cardinal par Léon XIII en 1890, qui, avec l’Union de Fribourg qu’il présidait, a tant contribué à la préparation de Rerum novarum, la première grande encyclique sociale. Certes, s’agissant de doctrine et non de pratique ou de prises de position ponctuelles, on s’en tiendra ici aux textes officiels du magistère du Pape, exprimé dans les encycliques sociales, ce qui ne sous-estime en rien l’importance, entre autres, des prises de position, telles celles des évêques dans le monde entier, visant à adapter ces principes généraux à la situation de chaque pays ou diocèse. L’Union de Fribourg, par exemple, a joué un rôle majeur pour préparer la prise de position du magistère, d’autant plus que la question des organisations professionnelles, du syndicalisme et des corporations était au cœur de leurs préoccupations. Beaucoup d’auteurs ont souligné l’influence de l’Union de Fribourg et de Mgr Mermillod sur la rédaction de Rerum novarum.
Suppression des corporations et interdiction des regroupements professionnels
Le premier grand texte du magistère en ce domaine est donc l’encyclique de Léon XIII, parue le 15 mai 1891, Rerum novarum, sur la condition des ouvriers. Concernant la question précise du syndicalisme, le point de départ de la réflexion de l’Église a été le fait que « le dernier siècle a détruit, sans rien leur substituer, les corporations anciennes, qui étaient pour eux une protection », disparition rendant les « travailleurs isolés et sans défense » (2).
Cette question de la disparition des corporations avait agité tout le XIX° siècle catholique, et les solutions pour y remédier avaient provoqué des clivages sensibles chez les catholiques, et notamment, peu avant Rerum novarum, des divergences entre l’école d’Angers (autour de monseigneur Freppel) et l’école de Liège (autour de monseigneur Doutreloux).
Certes, monseigneur Freppel exprime bien l’opinion assez générale des chrétiens en cette deuxième moitié du XIX° siècle, en expliquant qu’en 1789, « on voulait détruire les abus, et ils étaient graves, nombreux ; on voulait opérer des réformes, unanimement et à bon droit » et « non faire une révolution » (3).
Dans le domaine du travail, faisant l’éloge des corporations de l’ancien régime, en particulier pour leur rôle protecteur, monseigneur Freppel ne cache pas que le système s’était figé : « Que des abus s’y soient glissés à la longue, qu’il y ait eu nécessité d’introduire plus d’air, plus de jour, plus de mouvement, dans ces institutions devenues trop étroites, et faire une plus large part à la liberté du travail, personne ne le conteste. Là encore, il s’agissait d’opérer l’une de ces réformes justifiées par la marche du temps et par les progrès de l’industrie ». « Améliorer, à la bonne heure, mais détruire sans rien mettre à la place, c’est de la folie ». (4).
« Sous une apparence de liberté, c’est l’isolement qu’on apportait à l’ouvrier, et, avec l’isolement, la faiblesse ». « Plus de fraternité professionnelle ». « Plus de solidarité d’intérêt, d’honneur et de réputation » (5).
Au fond, ce qui était condamné, plus que le décret d’Allarde abolissant les corporations, c’était la loi le Chapelier, empêchant toute forme de regroupement, notamment dans le domaine du travail. Ce qui était mis en avant, c’est le « principe d’association si étrangement méconnu en 1789 », « dont c’est l’erreur fondamentale de ne concevoir et de n’admettre aucun organisme intermédiaire entre l’individu et l’État ». (6).
Mais si la plupart des Catholiques admettaient cette analyse, les divergences portaient sur ce qu’il fallait faire en cette fin du XIX° siècle pour remédier à cette situation. Revenir, pour l’essentiel, à des corporations obligatoires, quitte à ce que l’État joue un rôle important dans ce retour et dans cette obligation, ce qui était plutôt la position de l’école de Liège, ou imaginer des solutions plus souples et en tous cas plus volontaires, minimisant le rôle de l’Etat en la matière, ce qui était la position de l’école d’Angers. C’est un des points que devait trancher Léon XIII dans Rerum novarum et, contrairement à une idée très répandue, dans ce domaine précis, il a plutôt arbitré, ce qui n’est pas le cas sur d’autres sujets, en faveur de l’école d’Angers et d’une solution laissant une grande liberté d’organisation. Les historiens disent qu’il y a eu quatre rédactions de l’encyclique, une du père Liberatore, membre de l’Union de Fribourg, une seconde du cardinal Zigliaria, une troisième revue à nouveau par le père Liberatore et le cardinal Mazella et la quatrième, au stade de la rédaction latine, de Mgr Volpini, qui ajoutera l’idée de syndicats séparés, point fondamental s’il en est.
L’association, un droit naturel
Le premier point central soulevé par Léon XIII, est la question de la liberté d’association, dans le domaine du travail comme dans les autres. « Les sociétés privées n’ont d’existence qu’au sein de la société civile, dont elles sont autant de parties. Il ne s’ensuit pas cependant, à ne parler qu’en général et à ne considérer que leur nature, qu’il soit au pouvoir de l’État de leur dénier l’existence. Le droit à l’existence leur a été octroyé par la nature elle-même, et la société civile a été instituée pour protéger le droit naturel, non pour l’anéantir. C’est pourquoi une société civile (7) qui interdirait les sociétés privées s’attaquerait elle-même, puisque toutes les sociétés, publiques ou privées, tirent leur origine d’un même principe, la naturelle sociabilité de l’homme ». (8).
Voilà sans doute le point central : les associations sont de droit naturel. Les associations portant sur le travail ou regroupant des travailleurs sont donc de droit naturel et l’État ne peut les interdire. C’est un point essentiel sur lequel toute la doctrine sociale de l’Église insistera. C’est ainsi que dans son encyclique sur le centenaire de Rerum novarum, Jean-Paul II y reviendra dès le premier chapitre présentant les « traits caractéristiques de Rerum novarum », en parlant du « droit naturel de l’homme à fonder des associations privées » qui « occupe une place de premier plan ». « Il s’agit avant tout du droit à créer des associations professionnelles ». « S’associer est un droit naturel de l’être humain et, par conséquent, un droit antérieur à sa reconnaissance par la société politique ». (9).
Bien entendu, ce droit à se regrouper ne se limite pas aux associations professionnelles et Jean-Paul II approfondira ce thème, en utilisant un vocabulaire nouveau pour justifier l’existence de ce que l’on appelle habituellement les corps intermédiaires : « De la conception chrétienne de la personne résulte nécessairement une vision juste de la société. Selon Rerum novarum et toute la doctrine sociale de l’Église, le caractère social de l’homme ne s’épuise pas dans l’État, mais il se réalise dans divers groupes intermédiaires, de la famille aux groupes économiques, sociaux, politiques et culturels qui, découlant de la même nature humaine, ont -toujours à l’intérieur du bien commun- leur autonomie propre. C’est ce que j’ai appelé la personnalité de la société qui, avec la personnalité de l’individu, a été éliminée par le « socialisme réel ». » (10). Cette expression de « personnalité de la société » est très riche et large. En outre, ce que Léon XIII dénonçait à propos de l’interdiction par la Révolution française des associations professionnelles en particulier, Jean-Paul II le reproche au XX° siècle au socialisme réel des pays communistes, qui, lui, niait et la personnalité de l’individu et celle de la société.
Corporation ou syndicat ?
Une fois posé le principe, restait à en définir les modalités. Là encore, Léon XIII ouvre deux perspectives essentielles. La première, c’est que ces associations professionnelles, qui commençaient à se développer à son époque, étaient « soit composées des seuls ouvriers, soit mixtes, réunissant à la fois des ouvriers et des patrons. ». (11). Autrement dit, Léon XIII ne réclame pas forcément le retour à un système corporatif : il laisse le choix et envisage soit la corporation, soit le syndicat, suivant les circonstances, suivant en cela les modifications suggérées pour la quatrième version de l’encyclique. Il remarque d’ailleurs qu’en toute hypothèse, elles seront différentes des précédentes : « Il n’est donc pas douteux qu’il faille adapter les corporations à ces conditions nouvelles ». (11).
Il est donc faux de dire que dès l’origine, avec Léon XIII, la doctrine sociale de l’Église a demandé le rétablissement des corporations ; Léon XIII a laissé le choix. Mais il est vrai que l’évolution s’est faite entre la première rédaction, très corporatiste, et la dernière, favorable à une libre organisation professionnelle, y compris syndicale, c’est-à-dire ne regroupant que les salariés. Par la suite, le discours s’est peu à peu infléchi, tenant compte de l’évolution économique et sociale, et le terme de corporation sera de moins en moins utilisé, tandis que celui de syndicat deviendra dominant. Jean-Paul II expliquera d’ailleurs que si « les syndicats ont en un certain sens pour ancêtres les anciennes corporations d’artisans du Moyen Age », « les syndicats différent des corporations sur un point essentiel : les syndicats modernes ont grandi à partir de la lutte des travailleurs (…) pour la sauvegarde de leurs justes droits vis-à-vis des entrepreneurs » (12). Et il ajoute explicitement que « les organisations de ce type « (donc les syndicats) « sont un élément indispensable de la vie sociale, particulièrement dans les sociétés modernes industrialisées ». (12). D’ailleurs, de manière significative, le mot corporation n’existe pas dans l’important index analytique du Compendium de la Doctrine sociale de l’Eglise ; on n’y trouve que le terme « corporatisme » au sens des « tentations du corporatisme » (13) ou des « intérêts corporatifs » (14). En revanche, le mot syndicat apparait avec huit renvois dans le même index.
Une organisation libre
La seconde perspective ouverte par Léon XIII est tout aussi fondamentale. C’est le fait que les corporations ou syndicats doivent pouvoir s’organiser librement : « A ces corporations, il faut évidemment, pour qu’il y ait unité d’action et accord des volontés, une organisation et une discipline sage et prudente. Si donc, comme il est certain, les citoyens sont libres de s’associer, ils doivent l’être également de se donner les statuts et règlements qui leur paraissent les plus appropriés au but qu’ils poursuivent (…) Tout dépend du génie de chaque nation, des essais tentés et de l’expérience acquise, du genre de travail, de l’extension du commerce et d’autres circonstances de choses et de temps qu’il faut mûrement examiner ». (15). Ce n’est donc pas à l’État d’organiser les corporations ou les syndicats, de leur fixer des règles uniformes, encore moins de rendre l’adhésion obligatoire.
Pie XI reviendra à son tour sur cette question de la liberté d’organisation, en rappelant que « les hommes sont libres d’adopter telle forme d’organisation qu’ils préfèrent, pourvu seulement qu’il soit tenu compte des exigences de la justice et du bien commun » (16). Et il précisera « ainsi, les personnes qui exercent la même profession gardent la faculté de s’associer librement en vue de certains objets qui, d’une manière quelconque, se rapportent à cette profession ». Et plus loin encore, reprenant l’expression de « libres associations », il rappelle que l’homme est libre non seulement de les créer, mais encore de leur donner les statuts qui paraissent les plus appropriés et il parle explicitement alors de « sociétés d’ordre et de droit privé ». (17). Compte tenu du contexte de l’époque (on est en 1931), Pie XI fait ainsi une claire distinction entre la conception que l’Église se fait des corporations et syndicats et la conception fasciste qui régnait alors en Italie, dans laquelle les « corporations » sont obligatoires et étatisées. C’est ce qui fait toute la différence entre la société civile, cette fois au sens de Tocqueville, qui s’organise librement, et la société politique, dans laquelle ces organisations ont un caractère obligatoire et contraignant et ne sont au fond qu’un prolongement de l’État.
Bien entendu, on ne sera pas surpris que Léon XIII insiste aussi sur ce qui est pour lui « l’objet principal, qui est le perfectionnement moral et religieux. C’est surtout cette fin qui doit régler l’économie sociale. Autrement, ces sociétés dégénéreraient bien vite et tomberaient, ou peu s’en faut, au rang des sociétés où la religion ne tient aucune place. Aussi bien, que servirait à l’ouvrier d’avoir trouvé au sein de la corporation l’abondance matérielle, si la disette d’aliments spirituels mettait en péril le salut de son âme ? » 18). Il parle alors explicitement des « corporations des catholiques » (19) . Cet appel avait déjà été anticipé en France, par exemple avec le syndicat des employés de commerce et de l‘industrie créé en 1887 et trouvera son aboutissement en 1919, lorsque 321 syndicats constitueront la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).
Pas de lutte des classes
Les principes étant posés depuis l‘origine de la doctrine sociale de l’Église, quelle conception l’Église se fait-elle aujourd’hui du syndicat et du syndicalisme ? Le dernier grand texte qui aborde cette question, en tous cas sous forme d’encyclique, est Laborem exercens de Jean-Paul II en 1981. Bien sur, les grands textes ultérieurs, dont Centesimus annus, font allusion au syndicalisme, tandis que Benoit XVI, sans modifier les enseignements de son prédécesseur sur cette question, a apporté certaines réflexions intéressantes et novatrices dans Caritas in veritate. Il était logique que ce soit Jean-Paul II qui actualise cette question, d’une part parce que son encyclique de 1981 était consacrée à la question du travail humain, d’autre part parce qu’à l’époque, un renouveau syndical avait été observé sous une forme originale dans la Pologne communiste avec le syndicat Solidarité. Son analyse s’inspire beaucoup de cette expérience d’un syndicat qui lutte contre le totalitarisme et pour le bien commun.
Dans Laborem exercens, Jean-Paul II consacre tout le paragraphe 20 à la question de « l’importance des syndicats ». Les premiers alinéas rappellent le droit d’association, qui vaut bien entendu pour les salariés, comme pour d’autres groupes, la différence déjà citée entre corporation et syndicat, et surtout le fait que « la doctrine sociale catholique ne pense pas que les syndicats soient seulement le reflet d’une structure de classe de la société ; elle ne pense pas qu’ils soient les porte-parole d’une lutte de classe qui gouvernerait inévitablement la vie sociale. Certes, ils sont les porte-parole de la lutte pour la justice sociale, pour les justes droits des travailleurs selon leurs diverses professions. Cependant, cette « lutte » doit être comprise comme un engagement normal « en vue » du juste bien ; ici, du bien qui correspond aux besoins et aux mérites des travailleurs associés selon leurs professions ; mais elle n’est pas une « lutte contre » les autres ». (20).
On est ici en pleine cohérence avec la pensée de Léon XIII qui avait déjà expliqué que « l’erreur capitale dans la question présente, c’est de croire que les deux classes sont ennemies-nées l’une de l’autre » (21) ; « Les deux classes sont destinées par la nature à s’unir harmonieusement et à se tenir mutuellement dans un parfait équilibre. Elles ont un impérieux besoin l’une de l’autre ; il ne peut y avoir de capital sans travail, ni de travail sans capital. La concorde engendre l’ordre et la beauté » (22). On est donc loin de la conception marxiste de la lutte des classes et de la vision du syndicat comme instrument de la lutte des classes. On raisonne en termes de complémentarités, on dirait aujourd’hui de services réciproques. Jean-Paul II en tire la conclusion que « les requêtes syndicales ne peuvent pas se transformer en une sorte d’égoïsme de groupe ou de classe ». (23).
La question de la grève
Dans ces conditions, « le rôle des syndicats n’est pas de « faire de la politique » au sens que l’on donne aujourd’hui à ce terme. Les syndicats n’ont pas le caractère de « partis politiques » qui luttent pour le pouvoir, et ils ne devraient jamais non plus être soumis aux décisions des partis politiques ni avoir des liens trop étroits avec eux ». (24). On est loin, on le voit, de la conception du syndicat comme « courroie de transmission » du parti. Le but des syndicats, c’est « de défendre les justes droits des travailleurs dans le cadre du bien commun de toute la société ». (24). On est donc également loin de la simple défense égoïste d’intérêts catégoriels ou corporatistes, au sens péjoratif qu’a ce mot aujourd’hui. Jean-Paul II ajoute aussi que les syndicats doivent aider les travailleurs non seulement à « avoir » plus, mais à « être » davantage, pour réaliser pleinement leur humanité, en particulier grâce à l’éducation. (25).
Enfin, et ce point est essentiel à comprendre, en particulier dans la France actuelle, le pape n’élude pas et aborde de front la question de la grève. « C’est un procédé que la doctrine sociale catholique reconnaît comme légitime sous certaines conditions et dans de justes limites. Les travailleurs devraient se voir assurer le droit de grève et ne pas subir de sanctions pénales personnelles pour leur participation à la grève. Tout en admettant que celle-ci est un moyen juste et légitime, on doit également souligner qu’elle demeure, en un sens, un moyen extrême. On ne peut pas en abuser ; on ne peut pas en abuser spécialement pour faire le jeu de la politique. En outre, on ne peut jamais oublier que, lorsqu’il s’agit des services essentiels à la vie de la société, ces derniers doivent toujours être assurés, y compris, si c’est nécessaire, par de mesures légales adéquates. L’abus de la grève peut conduire à la paralysie de toute la vie socio-économique. Or cela est contraire aux exigences du bien commun de la société qui correspond également à la nature bien comprise du travail lui-même ». (26).
Ce passage est lumineux. Il n’est pas besoin d’insister sur le fait qu’il est à l’évidence ignoré de la plupart des syndicats français. Il existe de nombreux pays où les relations sociales sont consensuelles ; il y a bien entendu des désaccords, aboutissant à des conflits ; on commence alors par la discussion et la négociation ; et la grève est une arme ultime, en général encadrée dans ses conséquences, notamment pour les services publics. La France est à l’évidence une société conflictuelle, dans laquelle le conflit prime sur la négociation, le service minimum est illusoire ou rarement respecté, et où le syndicalisme est considéré par certains comme une arme politique. C’est même le seul pays où l’on a inventé l’expression de « troisième tour » social, comme « repêchage » des deux premiers tours d’une élection politique.
Le syndicalisme dans la mondialisation selon Benoît XVI
Dans Caritas in veritate (29 juin 2009), le pape Benoît XVI consacre un paragraphe à la question syndicale (le § 64), ce qui lui permet de suggérer certaines expériences syndicales novatrices.
« En réfléchissant sur le thème du travail, il est opportun d’évoquer l’exigence urgente que les organisations syndicales des travailleurs, qui ont toujours été encouragées et soutenues par l’Église, s’ouvrent aux nouvelles perspectives qui émergent dans le domaine du travail. Dépassant les limites propres des syndicats catégoriels, les organisations syndicales sont appelées à affronter les nouveaux problèmes de nos sociétés: je pense, par exemple, à l’ensemble des questions que les spécialistes en sciences sociales repèrent dans les conflits entre individu-travailleur et individu-consommateur. Sans nécessairement épouser la thèse selon laquelle on est passé de la position centrale du travailleur à celle du consommateur, il semble toutefois que cela soit un terrain favorable à des expériences syndicales novatrices. Le contexte d’ensemble dans lequel se déroule le travail requiert lui aussi que les organisations syndicales nationales, qui se limitent surtout à la défense des intérêts de leurs propres adhérents, se tournent vers ceux qui ne le sont pas et, en particulier, vers les travailleurs des pays en voie de développement où les droits sociaux sont souvent violés. La défense de ces travailleurs, promue aussi à travers des initiatives opportunes envers les pays d’origine, permettra aux organisations syndicales de mettre en évidence les authentiques raisons éthiques et culturelles qui leur ont permis, dans des contextes sociaux et de travail différents, d’être un facteur décisif du développement. L’enseignement traditionnel de l’Église reste toujours valable lorsqu’il propose la distinction des rôles et des fonctions du syndicat et de la politique. Cette distinction permettra aux organisations syndicales de déterminer dans la société civile le domaine qui sera le plus approprié à leur action nécessaire pour la défense et la promotion du monde du travail, surtout en faveur des travailleurs exploités et non représentés, dont l’amère condition demeure souvent ignorée par les yeux distraits de la société. ». (Benoît XVI, CIV, § 64).
Il y a là au moins trois thèmes importants : le syndicalisme est replacé au cœur de la société civile, et non de la société politique ; le débat entre les droits et les conflits entre individu-travailleur et individu-consommateur est clairement posé, ce qui est au cœur du processus de mondialisation ; enfin, le syndicalisme doit développer sa dimension internationale et notamment s‘intéresser aux travailleurs des pays en voie de développement : voilà autant de nouvelles perspectives qui s‘ouvrent, selon Benoît XVI, aux syndicats, pour déboucher sur des expériences syndicales novatrices.
Une opinion exigeante du syndicat
Ainsi, la doctrine sociale de l’Église se fait une haute opinion et une opinion exigeante du syndicat et des responsabilités du syndicalisme. Cela s’explique d’une part parce qu’elle a une haute opinion de la personne humaine, de sa dignité incomparable et de sa valeur unique (27) et d’autre part parce qu’elle a une haute opinion du travail « clé essentielle de toute la question sociale » (28) et « dimension fondamentale de l’existence de l’homme sur la terre » (29). Au-delà du seul travail, c’est toute l’activité humaine, et notamment l’activité économique, qui est visée et ainsi « l’homme est l’image de Dieu notamment par le mandat qu’il a reçu de son Créateur de soumettre, de dominer la terre. En accomplissant ce mandat, l’homme, tout être humain, reflète l’action même du Créateur de l’univers » (30).
Jean-Yves NAUDET
Professeur d’économie à l’Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III), Directeur du Centre de recherches en éthique économique, Président de l’Association des économistes catholiques de France, Vice-président de l’Association internationale pour l’enseignement social chrétien.
(1) Ce texte est une version remaniée et augmentée d’un article à paraitre in Guillaume Bernard et Jean-Pierre Deschodt, Les forces syndicales françaises, idées, organisations, institutions, Coll. Major, PUF, 2009
(2) Léon XIII, Rerum Novarum (RN), 1891, § 2-2
(3) Monseigneur Freppel, La révolution française, à propos du centenaire de 1789, Paris, A. Roger et F. Chernoviz, 1889, p. 8
(4) Monseigneur Freppel, op.cit., p. 75
(5) Monseigneur Freppel, op.cit., p. 77
(6) Monseigneur Freppel, op.cit., pp. 78-79
(7) Il faut bien noter que, dans le vocabulaire religieux de l’époque, on entend société civile par opposition à société ecclésiale, et non au sens de Tocqueville par exemple. Ce qui signifie que chez Léon XIII, la société civile inclut l’État, alors qu’au sens de Tocqueville, société civile s’oppose à société politique. La société civile qui interdirait les sociétés privées, c’est donc ici l’État qui interdirait les associations ou les syndicats par exemple
(8) Léon XIII, RN, § 38-1
(9) Jean-Paul II, Centesimus annus (CA), 1991, § 7
(10) Jean-Paul II, CA, § 13
(11) Léon XIII, RN, § 36-2
(12) Jean-Paul II, Laborem exercens (LE), 1981, § 20-2
(13) Conseil pontifical Justice et Paix, Compendium de la Doctrine sociale de l’Église, Libreria Editrice Vaticana, 2005, § 306
(14) Compendium…, op.cit., § 340
(15) Léon XIII, RN, § 42-1
(16) Pie XI, Quadragesimo anno (QA), 1931, § 93
(17) Pie XI, QA, § 94
(18) Léon XIII, RN, § 42-3
(19) Léon XIII, RN, § 43-7
(20) Jean-Paul II, LE, § 20-3
(21) Léon XIII, RN, § 15-1
(22) Léon XIII, RN, § 15-2
(23) Jean-Paul II, LE, § 20-4
(24) Jean-Paul II, LE, § 20-5
(25) Jean-Paul II, LE, § 20-6
(26) Jean-Paul II, LE, § 20-7
(27) Jean-Paul II, CA, § 11
(28) Jean-Paul II, LE, § 3-2
(29) Jean-Paul II, LE, § 4-1
(30) Jean-Paul II, LE, § 4-2

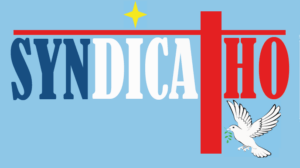
COMMENTAIRES RÉCENTS (5)