Commentaires des textes liturgiques de la Dédicace de la basilique de Latran A, B, C – 09 11 2025
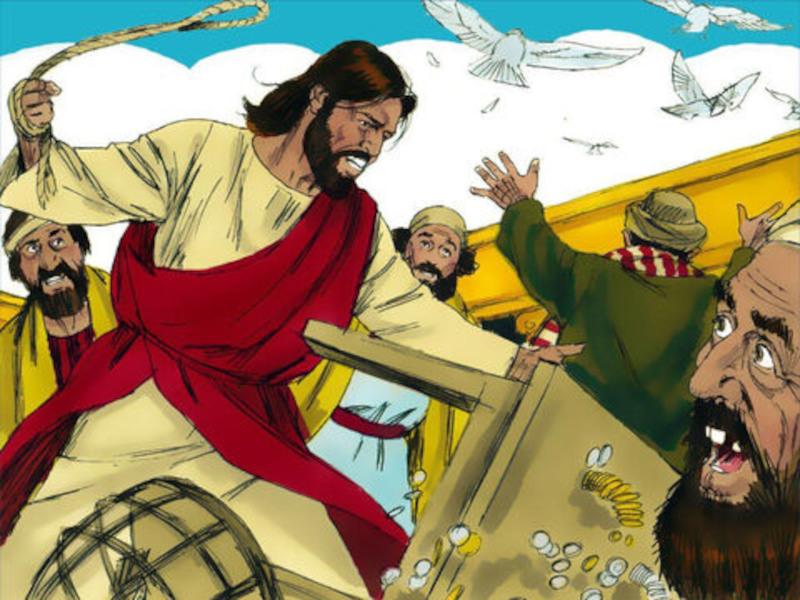
Jésus chasse les marchands du Temple (Jn 2, 13-22).
Image de Sweet Publishing / ImagesBibliquesgratuites.org. sous license Creative Commons.
1ère lecture.
Lecture du livre d’Ézéchiel 47, 1-2, 8-9, 12
En ces jours-là,
au cours d’une vision reçue du Seigneur,
1 l’homme me fit revenir à l’entrée de la Maison,
et voici : sous le seuil de la Maison,
de l’eau jaillissait vers l’orient,
puisque la façade de la Maison était du côté de l’orient.
L’eau descendait de dessous le côté droit de la Maison,
au sud de l’autel.
2 L’homme me fit sortir par la porte du nord
et me fit faire le tour par l’extérieur,
jusqu’à la porte qui fait face à l’orient,
et là encore l’eau coulait du côté droit.
8 Il me dit :
« Cette eau coule vers la région de l’orient,
elle descend dans la vallée du Jourdain,
et se déverse dans la Mer Morte,
dont elle assainit les eaux.
9 En tout lieu où parviendra le torrent,
tous les animaux pourront vivre et foisonner.
Le poisson sera très abondant,
car cette eau assainit tout ce qu’elle pénètre,
et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent.
12 Au bord du torrent, sur les deux rives,
toutes sortes d’arbres fruitiers pousseront :
leur feuillage ne se flétrira pas
et leurs fruits ne manqueront pas.
Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux,
car cette eau vient du sanctuaire.
Les fruits seront une nourriture,
et les feuilles un remède. »
Commentaires écrits de Marie-Noëlle Thabut, bibliste.
Avant de relire le récit de cette vision par Ézéchiel, il faut nous remettre en tête le plan du Temple qu’Ézéchiel a connu, c’est-à-dire celui de Salomon. Il est très différent de nos églises modernes : pour nous, une église, quel que soit son plan, c’est avant tout un bâtiment dans lequel tout converge vers l’autel.
Tandis qu’à Jérusalem, il s’agit d’abord d’une vaste esplanade découpée en plusieurs cours (qu’on appelait des parvis) : dans l’ordre, on traversait le parvis des païens, puis celui des femmes, puis celui des hommes. Ensuite, le Temple lui-même comportait trois parties : la première en plein air, sur laquelle se trouvait l’autel des holocaustes ; c’est ce qui, pour nous, est le plus surprenant, mais bien compréhensible si on se rappelle que les sacrifices consistaient à égorger ou à brûler des animaux. Enfin venait la Maison de Dieu elle-même, qui comprenait trois parties, le Vestibule, le Saint et le Saint des Saints.
Ensuite, il nous faut faire un effort pour imaginer ce que pouvait représenter le temple de Jérusalem pour le peuple d’Israël ; à la suite d’un vigoureux effort de réforme religieuse qui s’était étalé sur plusieurs siècles, le Temple de Jérusalem était devenu l’unique lieu de pèlerinage et de sacrifices ; il était donc vraiment le centre de la vie cultuelle d’Israël. Le jour où il s’écroulait, tout le système du culte s’écroulait ; la foi allait-elle s’écrouler avec ? Telle était la question !
SURVIVRE APRÈS LA DESTRUCTION DU TEMPLE
Or le Temple s’est écroulé : avec l’entrée des armées de Nabuchodonosor à Jérusalem en 587 av. J.-C.
Le prophète Ézéchiel, lui, a été emmené à Babylone, dès la première vague de déportations en 597 av. J.-C. Il se retrouve au bord du fleuve Kebar, dans un village qui s’appelle Tel-Aviv.1
Pendant les vingt premières années de l’Exil, (dix ans avant la destruction de Jérusalem et du Temple, et dix ans à peu près ensuite) Ézéchiel a consacré toutes ses forces à maintenir l’espérance de son peuple. Pour cela, il lui fallait se battre sur deux fronts : premièrement, il fallait bien survivre ; deuxièmement, il fallait maintenir intacte l’espérance du retour. Ces deux objectifs sont ceux d’Ézéchiel tout au long de son livre, et ce sont les deux axes de sa prédication ; comme il est prêtre, il les aborde le plus souvent en termes de culte et de rites ; plusieurs de ses visions (dont celle d’aujourd’hui) concernent en particulier le Temple, qu’il appelle la « Maison » sous-entendu « du Seigneur ».
Premièrement, il faut bien apprendre à survivre ! Or c’est la catastrophe, sur tous les plans ; on a tout perdu et le désespoir n’est pas loin. Évidemment, le rôle d’un prêtre, c’est de rappeler que, quelles que soient les apparences, on peut être sûr que Dieu n’a pas abandonné son peuple. On lui répond « mais le Temple de Jérusalem est détruit ; et tu sais mieux que personne, toi le prêtre, que la présence de Dieu habitait dans le Temple ». Ézéchiel sait qu’il va bien falloir apprendre à se passer de Temple ; alors, dans sa foi, il trouve la réponse : le Temple n’était pas le lieu de la présence de Dieu, il en était seulement le signe. Il leur dit en substance : « vous savez bien, mes frères, que la présence de Dieu n’est pas géographiquement limitée ; Salomon l’avait dit avant moi : « Les cieux eux-mêmes et les cieux des cieux ne peuvent te contenir ! Combien moins cette Maison que j’ai bâtie ! » (1 R 8,27).
DIEU EST AU MILIEU DE SON PEUPLE
Il en a la certitude, Dieu n’est pas resté au milieu des ruines de Jérusalem, il est au milieu de son peuple sur les rives du fleuve Kébar. Car c’est une chose acquise depuis l’Alliance du Sinaï : Dieu n’est pas le Dieu d’un lieu, d’un espace géographique, il est le Dieu d’un peuple. Avant la construction du Temple, Dieu était déjà au milieu de son peuple ; après la destruction du Temple, il y est encore et tout autant. Si bien que, une fois de plus, au milieu même de son malheur, Israël a approfondi sa foi.
Deuxièmement, il fallait garder vive au cœur l’espérance du retour : parce que Dieu est fidèle, ses promesses sont toujours valables et c’est le moment ou jamais de se les rappeler ; et donc Ézéchiel imagine déjà le Temple de demain : c’est le sens de la vision qui nous est racontée aujourd’hui.
On se souvient que le Temple était construit sur la colline, au nord de Jérusalem et était disposé selon un axe ouest-est. Pour les auditeurs d’Ézéchiel, la référence aux points cardinaux était donc très parlante : « sous le seuil de la Maison, de l’eau jaillissait vers l’orient, puisque la façade de la Maison était du côté de l’orient. L’eau descendait de dessous le côté droit de la Maison au sud de l’autel. » Cette précision dans la description ne donnait que plus de crédibilité à la promesse contenue dans cette vision.
Car cette eau si abondante dont parle le prophète est en elle-même une promesse : la Mer Morte ne sera plus morte, toutes sortes de poissons foisonneront… Les détails qu’il donne font évidemment penser à la description du Paradis dans le livre de la Genèse : « Dieu dit que la terre se couvre d’arbres fruitiers qui, selon leur espèce, portent sur terre des fruits ayant en eux-mêmes leur semence…Que les eaux grouillent de bestioles vivantes et que l’oiseau vole au-dessus de la terre face au firmament du ciel… » (Gn 1).
LA MER MORTE NE SERA PLUS MORTE
En écho Ézéchiel voit déjà la vie qui apparaît en tout lieu où arrive le torrent issu du Temple reconstruit. Manière de dire à ses contemporains : « Le paradis n’est pas derrière nous, il est devant. Tous nos rêves d’abondance, d’harmonie seront comblés. Car Dieu ne nous a pas abandonnés, ses largesses ne sont pas épuisées. » Si les Juifs, quelques décennies plus tard, ont trouvé la force de reconstruire le temple, malgré toutes les difficultés, c’est peut-être bien à l’opiniâtre espérance d’Ézéchiel qu’ils le doivent.
————————————————————————————————————————————
Note
1- Est-ce en souvenir d’Ézéchiel et du magnifique sursaut d’espérance qu’il a incarné pour tout son peuple en exil que la capitale d’Israël aujourd’hui porte ce nom : « Tel Aviv , colline du printemps ?
Commentaires vidéo de Marie-Noëlle Thabut, bibliste.
Psaume
PSAUME 45 (46)
2 Dieu est pour nous refuge et force,
secours dans la détresse, toujours offert.
3 Nous serons sans crainte si la terre est secouée,
si les montagnes s’effondrent au creux de la mer ;
4 ses flots peuvent mugir et s’enfler,
les montagnes trembler dans la tempête.
[R/]
5 Le Fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu,
la plus sainte des demeures du Très-Haut.
6 Dieu s’y tient : elle est inébranlable ;
quand renaît le matin, Dieu la secourt.
7 Des peuples mugissent, des règnes s’effondrent ;
quand sa voix retentit, la terre se défait.
8 [R/ Il est avec nous, le SEIGNEUR de l’univers :
citadelle pour nous, le Dieu de Jacob !]
9 Venez et voyez les actes du SEIGNEUR ;
comme il couvre de ruines la terre.
10 Il détruit la guerre jusqu’au bout du monde,
il casse les arcs, brise les lances, incendie les chars :
11 (Il dit) « Arrêtez ! Sachez que je suis Dieu.
Je domine les nations, je domine la terre. »
12 [R/ Il est avec nous, le SEIGNEUR de l’univers :
citadelle pour nous, le Dieu de Jacob !]
Commentaires écrits de Marie-Noëlle Thabut, bibliste.
La liturgie prévue pour la fête de la Dédicace ne nous propose qu’un découpage du psaume 45/46. Mais je me suis permis de le transcrire en entier car c’est, me semble-t-il la condition pour comprendre de quoi il s’agit.
Il se présente comme un cantique de trois strophes coupées par deux refrains : « Il est avec nous, le SEIGNEUR de l’univers ; citadelle pour nous, le Dieu de Jacob ! »
DIEU, ROI DU MONDE
Des trois strophes, la première dit la maîtrise de Dieu sur les éléments cosmiques : la terre, la mer, les montagnes… La seconde parle de Jérusalem sans la nommer, « la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. ». La troisième strophe dit la maîtrise de Dieu sur les nations, ce qui en langage biblique veut dire tous les autres peuples, sur toute la terre : « Je domine les nations, je domine la terre. »
Quant au refrain, il sonne comme un cri de victoire, presque un cri de guerre : « Il est avec nous, le SEIGNEUR de l’univers : citadelle pour nous, le Dieu de Jacob ! » d’autant plus que le nom donné à Dieu ici (qui a été traduit par « Dieu de l’univers ») est en réalité « le SEIGNEUR Sabaoth » qui veut dire « Dieu des armées ». Au début de l’histoire biblique, c’était certainement un titre guerrier. On attendait de Dieu qu’il prenne la tête de nos armées. Et l’Arche d’Alliance, qui symbolisait la présence de Dieu au milieu des tribus d’Israël, était portée en avant des armées sur les champs de bataille.
Maintenant, certains préfèrent lire le nom « Sabaoth » qui veut dire « armées » au sens des armées du ciel, et c’est pour cela qu’actuellement on traduit « Dieu Sabaoth » par « Dieu de l’univers ».
Je reviens sur la deuxième strophe, celle du milieu, car elle est un peu surprenante : « Le Fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s’y tient : elle est inébranlable ; quand renaît le matin, Dieu la secourt. » Manifestement, il s’agit de Jérusalem. On sait l’amour du peuple d’Israël pour Jérusalem ; et donc, comme dans tout amour on ne s’étonne pas d’entendre des formules hyperboliques pour parler de la ville qu’on appelle « sainte » non pas à cause de ses vertus, mais tout simplement parce qu’elle est la ville de Dieu.
UN FLEUVE À JÉRUSALEM ?
Mais la surprise est dans l’évocation d’un Fleuve : il n’y a pas le moindre fleuve à Jérusalem ! Du moins rien qui mérite ce nom. Au contraire, les rois ont dû faire des travaux considérables pour assurer l’approvisionnement en eau qui dépend d’une unique source, celle de Gihôn ; (la fameuse piscine de Siloé est l’un des nombreux aménagements dus à ces travaux à partir de la source de Gihôn.)
Un peu plus loin, il y a une autre source, Aïn Roguel, mais elle non plus ne mérite pas le nom de fleuve.
Cela ne veut pas dire que notre psalmiste a perdu la tête, cela veut seulement dire qu’il pense à autre chose, il pense à plus tard. A-t-il en tête la prophétie d’Ézéchiel que nous lisons ce dimanche en première lecture ? La description d’un Fleuve immense et merveilleux qui irriguerait définitivement et miraculeusement toute la région jusqu’à la mer Morte qui deviendrait vivante.
On trouve une évocation analogue et qui ressemble très fort à notre psaume chez le prophète Joël : « Le SEIGNEUR rugit de Sion, de Jérusalem il donne de la voix ; alors les cieux et la terre sont ébranlés, mais le SEIGNEUR est un abri pour son peuple, un refuge pour les Israélites… Ce jour-là une source jaillira de la Maison du SEIGNEUR et elle arrosera la vallée des Acacias (en Moab). » (Jl 4,16-18).
Évocation reprise beaucoup plus tard par le prophète Zacharie : « En ce jour-là des eaux vives sortiront de Jérusalem, moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi l’été comme l’hiver. Alors le SEIGNEUR se montrera le roi de toute la terre. En ce jour-là le SEIGNEUR sera unique et son nom unique. » (Za 14,8).
L’ATTENTE DU JOUR DE DIEU
Elle est peut-être bien là la clé de ce psaume : toutes ses hyperboles sont l’anticipation de ce que la Bible appelle le « Jour de Dieu », le Jour de la victoire définitive de Dieu sur toutes les forces du Mal. D’où la tonalité guerrière dans les refrains, nous l’avons vu, mais aussi dans la dernière strophe : « Venez et voyez les actes du Seigneur ; comme il couvre de ruines la terre. Il détruit la guerre jusqu’au bout du monde, il casse les arcs, brise les lances, incendie les chars : (Il dit) « Arrêtez ! Sachez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine la terre. » Manière de dire « Dieu fait la guerre à la guerre ».
La domination de Dieu (ce que nous appelons le Règne de Dieu) sera enfin instaurée sur toute la terre, sur tous les peuples ; et surtout, surtout on verra la fin de toutes les guerres : c’est le rêve que caresse Israël depuis que sa cité sainte s’appelle « Jérusalem », ce qui veut dire « Ville de la Paix ».
————————————————————————————————————————————
Complément
Pour certains commentateurs, le Fleuve évoqué à Jérusalem est la marée humaine qui traverse la ville lors des grandes processions.
Commentaires vidéo de Marie-Noëlle Thabut, bibliste.
2e lecture
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE L’APÔTRE PAUL AUX CORINTHIENS 3, 9c-11.16-17
Frères,
9 vous êtes une maison que Dieu construit.
10 Selon la grâce que Dieu m’a donnée,
moi, comme un bon architecte,
j’ai posé la pierre de fondation.
Un autre construit dessus.
Mais que chacun prenne garde
à la façon dont il contribue à la construction.
11 La pierre de fondation, personne ne peut en poser d’autre
que celle qui s’y trouve : Jésus Christ.
16 Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu,
et que l’Esprit de Dieu habite en vous ?
17 Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu,
cet homme, Dieu le détruira,
car le sanctuaire de Dieu est saint,
et ce sanctuaire, c’est vous.
Commentaires écrits de Marie-Noëlle Thabut, bibliste.
DIEU PARMI LES HOMMES
Les croyants de l’Ancien Testament appelaient de tous leurs vœux le jour béni où Dieu serait pour toujours au milieu de son peuple et instaurerait son règne de paix et de justice. Par exemple, le dernier mot du livre d’Ézéchiel disait cette certitude : il imaginait le nouveau nom donné à Jérusalem « À partir de ce jour, le nom de la ville sera : le SEIGNEUR est là » (Ez 48,35).
Mais personne n’aurait pu imaginer jusqu’où irait cette présence de Dieu : jusqu’à venir, homme, parmi les hommes. D’où l’émerveillement des auteurs du Nouveau Testament : Jean, par exemple, qui dit « Et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, (c’est-à-dire sa présence)… » (Jn 1,14) ou encore : « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de Vie… nous vous l’annonçons. » (1 Jn 1,1-2).
Saint Paul fait partie de ceux qui relisent inlassablement l’Ancien Testament pour y découvrir comment ce mystère de l’Incarnation y est enraciné. Pour lui, il est évident que Jésus est celui vers qui tout convergeait dès l’origine ; pour lui, Jésus-Christ est vraiment, et depuis toujours, le centre du projet de Dieu. Ce projet que « Dieu avait d’avance arrêté en lui-même », comme il le décrit dans la lettre aux Éphésiens. Dieu a longuement, patiemment préparé son peuple, et quand les temps furent accomplis, il a mis à exécution son projet. Le signe de sa présence au milieu de son peuple n’a plus été un lieu, Jérusalem, et une construction de bois doré ou de pierres, le Temple, mais un homme, Jésus de Nazareth, et à sa suite tous ceux qui ont été greffés sur lui par le Baptême.
Plusieurs scènes d’évangile expriment ce mystère, chacune à sa manière : que ce soit la Présentation de Jésus au Temple, chez Luc, ou la déchirure du voile du Temple au moment de la mort du Christ (chez les trois évangiles synoptiques) ou (chez Jean) l’épisode du coup de lance du soldat et l’eau sortit du côté de Jésus comme Ézéchiel la voyait sortir du Temple nouveau ; ou enfin (et c’est l’évangile de cette fête de la Dédicace) l’épisode de la purification du Temple, (un épisode que les quatre évangiles rapportent.) Sans parler de la lettre aux Hébreux dont c’est le thème majeur. Donc il est clair pour tous les apôtres de la première génération chrétienne que le signe de la présence de Dieu au milieu des hommes est le Christ lui-même.
LE NOUVEAU SIGNE DE LA PRÉSENCE DE DIEU
Mais une fois Jésus mort et ressuscité, et donc devenu invisible aux yeux des hommes où est le signe de la présence de Dieu ? Paul répond tout simplement « En vous mes frères ! » : « Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? » Vous individuellement et vous collectivement. Car le texte que nous venons d’entendre doit être compris à ces deux niveaux : le niveau personnel et le niveau ecclésial.
Au niveau ecclésial d’abord : Paul développe ce thème dans la lettre aux Éphésiens : « Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et Jésus Christ lui-même comme pierre maîtresse. C’est en lui que toute construction s’ajuste et s’élève pour former un temple saint dans le Seigneur. C’est en lui que, vous aussi, vous êtes ensemble intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu par l’Esprit. » (Ep 2,20-22).
Si la communauté chrétienne est le nouveau temple de Dieu, on voit l’importance de la qualité du signe qu’elle représente ! Elle peut être pour ses contemporains un obstacle à la manifestation de Dieu comme elle peut être le signe que Dieu attend : d’où la mise en garde de Paul tout aussi utile pour nous aujourd’hui que pour les Corinthiens ! « Que chacun prenne garde à la façon dont il construit. » Un peu plus loin, dans cette même lettre, Paul précise quel doit être le critère de toutes nos actions : « (parmi vous) Que tout se fasse pour l’édification commune. » (1 Co 14,26). Je remarque, une fois de plus, combien Pierre est proche de Paul : « Vous-mêmes, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la Maison habitée par l’Esprit, pour constituer une sainte communauté sacerdotale, pour offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. » (1 Pi 2,5).
UN ÉDIFICE EN CONSTRUCTION
Le nouveau Temple de Dieu n’est donc pas un édifice immobile, fût-ce la plus belle des cathédrales… mais comme le disait le cardinal Daniélou « un Temple se dilatant sans cesse dans une croissance infinie » (Daniélou, « le signe du Temple »). (Il parlait d’une « vision vertigineuse d’univers spirituels en expansion… »).
Au niveau personnel, chacun de nous de façon inouïe, est élevé à la dignité de « porteur de l’Esprit » si l’on peut dire : « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous et qui vous vient de Dieu et que vous ne vous appartenez pas ? » (1 Co 6,19). Le rite de l’onction avec le saint chrême lors du Baptême, comme le rite de l’encensement du corps du défunt, aux funérailles, traduisent cette présence de l’Esprit de Dieu dans un corps humain.
Ce mystère est trop extraordinaire, trop beau, trop grave pour être méprisé ; alors Paul ajoute : « Si quelqu’un détruit le Temple de Dieu, Dieu le détruira : car le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c’est vous. » Paul ne précise pas qui peut être ce quelqu’un qui chercherait à détruire le temple de Dieu, ce Temple que nous sommes ; en tout cas, ce qui est clair, c’est que ceux qui nous voudraient du mal n’ont qu’à bien se tenir ! Je crois qu’il faut entendre là un écho de la promesse de Jésus à Pierre : « Les forces de l’enfer (entendez les forces du mal) ne l’emporteront pas contre mon Église. »
Commentaires vidéo de Marie-Noëlle Thabut, bibliste.
Évangile.
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT JEAN (2, 13-22)
13 Comme la Pâque juive était proche,
Jésus monta à Jérusalem.
14 Dans le Temple, il trouva installés
les marchands de bœufs, de brebis et de colombes,
et les changeurs.
15 Il fit un fouet avec des cordes,
et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ;
il jeta par terre la monnaie des changeurs,
renversa leurs comptoirs,
16 et dit aux marchands de colombes :
« Enlevez cela d’ici.
Cessez de faire de la maison de mon Père
une maison de commerce. »
17 Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit :
L’amour de ta maison fera mon tourment.
18 Des Juifs l’interpellèrent :
« Quel signe peux-tu nous donner
pour agir ainsi ? »
19 Jésus leur répondit :
« Détruisez ce sanctuaire,
et en trois jours je le relèverai. »
20 Les Juifs lui répliquèrent :
« Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire,
et toi, en trois jours tu le relèverais ! »
21 Mais lui parlait du sanctuaire de son corps.
22 Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts,
ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ;
ils crurent à l’Écriture
et à la parole que Jésus avait dite.
Commentaires écrits de Marie-Noëlle Thabut, bibliste.
DU COMMERCE SUR L’ESPLANADE
Transportons-nous à Jérusalem au temps de Jésus. Qu’il y ait des marchands de bestiaux et des changeurs de monnaie dans les environs du Temple, c’était bien normal et même indispensable : quand on vient en pèlerinage à Jérusalem, parfois de très loin, on s’attend bien à trouver sur place des bêtes à acheter pour les offrir en sacrifice. Quant aux changeurs de monnaie, on en a besoin aussi : on est sous occupation romaine, et les pièces utilisées en ville sont frappées à l’effigie de l’empereur ; mais du coup elles sont interdites au Temple ! Donc, en arrivant au Temple on change ce qu’il faut de monnaie romaine contre de la monnaie juive.
Mais ce qui choque Jésus, c’est que, au lieu de rester à l’extérieur, peu à peu les marchands s’étaient rapprochés du Temple au point de s’installer carrément sur l’esplanade, dans la première cour. (J’ai trouvé cette explication dans les commentaires d’André Chouraqui)
Aux yeux de Jésus, on est en train de transformer insidieusement ce lieu de prière et d’étude des Écritures en « Maison de commerce ». D’où sa colère, car on ne peut pas avoir deux maîtres : Dieu et l’Argent.
Il réagit exactement comme les prophètes : Le reproche qu’il fait aux vendeurs (« Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce ») rappelle une phrase de Jérémie qui, un jour de colère également, avait lancé : « Cette Maison sur laquelle mon Nom a été proclamé, la prenez-vous donc pour une caverne de bandits ? » (Jr 7,11). Et le prophète Zacharie avait annoncé « Il n’y aura plus de marchand dans la Maison du SEIGNEUR le tout-puissant en ce jour-là » (sous-entendu le jour de la venue du Messie – Za 14,21).
DEUX RÉACTIONS OPPOSÉES
Face à lui, on réagit de deux manières différentes : d’un côté, il y a ses disciples, de l’autre, ceux que Jean appelle « les Juifs ». En réalité, juifs, ils le sont tous, mais dans le langage de Jean, cela veut presque toujours dire « opposants ».
Ses disciples, ceux qui le connaissent déjà, qui ont assisté au miracle de Cana, qui ont commencé à croire en lui, se souviennent du psaume 68 / 69 qui disait : « le zèle de ta maison m’a dévoré ». C’est la plainte d’un croyant qui est persécuté à cause de sa foi : « Dieu d’Israël ! C’est pour toi que j’endure l’insulte, que la honte me couvre le visage : je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L’amour de ta maison m’a perdu ; on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. » (Ps 68/69,8-10). Le psaume, lui, parle au passé : « L’amour de ta maison m’a perdu », alors que Jean reprend cette phrase au futur : « L’amour de ta maison fera mon tourment ». Manière d’annoncer la persécution qui attend Jésus et qui commence déjà d’ailleurs ! Nous sommes encore au tout début de l’évangile de Jean, mais le procès de Jésus est déjà esquissé.
Les disciples donc reconnaissent dans l’attitude de Jésus un geste prophétique. En revanche, les autres, ceux que Jean appelle « les Juifs » n’ont pas l’intention de s’en laisser remontrer : ce prétendu prophète ne va pas leur faire la leçon. Ils exigent une explication.
LE NOUVEAU TEMPLE
La réponse de Jésus ne peut pas les satisfaire : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai ». Pour l’instant, c’est le quiproquo total : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours, tu le relèverais » ; en bonne logique, on ne peut pas leur donner tort.
Et encore, quand ils comptent quarante-six ans, les Juifs ne parlent pas de la construction du Temple à partir de rien ! Ils parlent des travaux de restauration entrepris par Hérode. Ce Temple magnifique, désormais, respecté de tous, parce qu’il est le signe manifeste de la présence de Dieu au milieu de son peuple, ce Temple n’attend rien du charpentier de Nazareth. Avec son histoire de trois jours, il est un peu court…
Oui mais, ce n’est pas avec notre bonne logique à nous que l’on peut prétendre aborder les mystères de Dieu. Les disciples, non plus, n’ont pas tout compris tout de suite. Mais ils ont certainement été alertés par le chiffre de trois jours. Car, pour un Juif, habitué de l’Écriture, trois jours c’était un chiffre dont on parlait souvent : c’était une manière de dire que l’intervention de Dieu ne tarderait pas
Alors tout s’est éclairé pour eux quand est venu ce troisième jour de la Résurrection du Christ. « Quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ». Et c’est à ce moment-là qu’ils comprirent quelle révolution venait de s’opérer : désormais le signe de la Présence de Dieu parmi les hommes est le corps ressuscité du charpentier de Nazareth. « Pierre rejetée par les bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle. »
————————————————————————————————————————————–
Complément
Nous sommes au tout début de l’évangile de Jean, au chapitre 2 : dans le premier chapitre, le « Prologue » Jean a dressé comme en une sorte de vitrail tout le mystère de la personne du Christ : un mystère que certains ont accueilli dans un cœur ouvert et ils sont devenus ses disciples ; mais d’autres se sont fermés à cette révélation inouïe de Dieu dans un corps d’homme et ils sont peu à peu devenus ses ennemis. « Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. » (Jn 1,10-12). Cette distinction entre deux groupes (les disciples, et les « Juifs ») est l’un des grands clivages de l’évangile de Jean.
Commentaires vidéo de Marie-Noëlle Thabut, bibliste.
Homélie / étude biblique du père Julien Fleuy, du diocèse de Marseille, pour Culture-Bible.
Homélie prononcée par Mgr Jean-Marc Aveline (vidéo + texte) – Le Jour-du-Seigneur, 9/11/2025
« Jésus fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs et dit aux marchands de colombes : “Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce.” »
Le récit de cet épisode si impressionnant et si décisif dans la vie de Jésus figure, nous le savons, dans les quatre Évangiles. Mais alors que chez les trois autres, il est placé à la fin du ministère de Jésus, peu avant son arrestation et sa Passion, car son geste est comme la goutte d’eau qui fait déborder le vase et qui finit de convaincre ses adversaires qu’il faut l’éliminer, chez saint Jean, le même épisode est situé non pas à la fin mais au tout début du récit évangélique, alors que Jésus ne fait que commencer son ministère public.
Comme si saint Jean voulait nous aider à comprendre que le drame de la Passion, qui fera se lever sur le monde l’aurore du salut, n’est pas la simple conséquence d’une hostilité progressive des opposants à Jésus, qui auraient fini par convaincre Pilate de le livrer à la mort, mais bien plutôt l’intention profonde du Fils de Dieu dans son Incarnation : « Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne ! » (Jn 10, 18). Comme s’il nous invitait, au seuil de son Évangile, à contempler déjà le Mystère pascal, faisant le lien entre le Verbe et la croix, entre la splendeur de la gloire et le prix de la grâce. Avant que, dès la fin du chapitre 12, Jésus ne soit contraint de se cacher, de ne plus parler en public, de vivre comme un homme traqué, il avait déclaré à ses disciples ces mots qu’annonçait déjà l’épisode des vendeurs du Temple : « C’est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Mais moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes » (Jn 12, 31-32).
Laissons-nous attirer par Lui, frères et sœurs, car c’est en Lui que notre vie prend sens, c’est en Lui seulement qu’elle trouve son salut, loin de toute activité mercantile faussement religieuse. Avec la force de son Esprit, apprenons à renoncer aux marchandages intérieurs par lesquels nous refusons de nous abandonner à Lui et de Lui faire confiance en toutes choses. Cessons de faire du trafic avec les choses de Dieu, en les utilisant sournoisement pour asseoir notre pouvoir, pour couvrir des injustices, des violences ou des agressions. Ne parlons pas du Christ comme si l’on pouvait se servir de sa gloire sans avoir éprouvé dans notre chair quelque
chose de la douleur de sa croix. Ne l’humilions pas davantage en prétendant le suivre, alors même que nous nous tenons éloignés de nos frères humains, si nombreux aujourd’hui, qui connaissent comme Lui la détresse de l’homme traqué et défiguré, calomnié et méprisé. Car depuis que le Verbe s’est fait chair, la maison de son Père n’est plus un bâtiment, si beau soit-il, mais bien cette chair, cette condition humaine, cette humanité si fragile et si faillible où Il a pourtant choisi de venir établir sa demeure. « Si quelqu’un m’aime, avait dit Jésus, il observera ma parole, et mon Père l’aimera ; nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure » (Jn 14, 23). « Je te cherchais dehors, disait saint Augustin, mais tu étais dedans, plus intérieur à moi-même que moi-même ! »
Mais il faut bien reconnaître que nous avons beaucoup de mal, aujourd’hui, à retrouver le chemin de l’intériorité ! Comme si une amnésie spirituelle nous avait saisis, avec ses effets secondaires que sont la tristesse, le désespoir, et finalement la peur, engendrant à son tour la division et la violence. La crise que traverse notre monde provient d’une blessure spirituelle, nous a dit en début de semaine notre frère orthodoxe Bartholomée Ier, patriarche œcuménique de Constantinople, invité à Lourdes pour l’ouverture de l’Assemblée plénière des évêques de France. « Lorsque Dieu disparaît du regard humain, la terre devient un bien à exploiter, l’autre un rival à craindre et la vie elle-même une marchandise. » Et hier soir, nous avons pu écouter d’autres paroles fortes que nous a adressées le cardinal Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, à propos de la situation actuelle en Terre Sainte. « Ne laissons pas la guerre façonner nos esprits ! », a-t-il insisté, invitant les communautés chrétiennes à vivre jusqu’au bout une proximité solidaire avec les plus pauvres, dans l’humilité et la fidélité, partageant la joie de l’Évangile jusque dans la détresse du quotidien.
Frères et sœurs, nous le savons : la proximité est la signature de Dieu dans sa révélation : « J’ai entendu la misère de mon peuple, […] je connais ses souffrances » (Ex 3, 7) lit-on au livre de l’Exode. C’est cela, en définitive, la dédicace de Dieu, la signature qui atteste sa présence, le geste par lequel, en son Fils, il signe l’œuvre du salut en en accomplissant les signes, libérant les captifs, guérissant les infirmes, pardonnant aux pécheurs, prenant soin des pauvres et des petits, donnant à tous sa paix. En ce jour où nous fêtons la dédicace de la basilique de Saint-Jean du Latran, « Mère et Tête de toutes les églises de la Ville et du monde », comme le proclame son fronton, demandons au Seigneur de nous aider à imiter sa signature, en n’ayant pas peur de nous comporter en hommes et femmes libres à cause de l’Évangile ! Libres à l’égard des idoles de tous les Temples d’aujourd’hui et de leurs trafics en tous genres ! Libres de réveiller les consciences, la nôtre et celles de nos contemporains, quand nous gagnent l’amnésie spirituelle et son cortège de maux. Libres de ne pas laisser les idéologies ni les algorithmes formater nos esprits et les rendre vulnérables aux puissants de ce monde. Libres de nous faire proches, à cause de l’Évangile, de tous ceux que la société préfère ignorer et rejeter.
Un seul épisode, dans l’Évangile de Jean, excepté le Prologue, est situé avant la scène de l’expulsion des vendeurs du Temple : c’est celui des noces de Cana. En racontant comment Marie attire l’attention de son Fils sur le vin qui vient à manquer, saint Jean nous suggère que la confiance que sa mère place en Lui devient pour Jésus comme une goutte d’eau qui fait déborder les jarres de son cœur miséricordieux et suscite ainsi la foi de ses premiers disciples, devant la gloire qui se manifeste en Lui et non plus dans le Temple, devenu une maison de commerce. Avec tous les pèlerins de Lourdes, demandons à la Mère de Dieu de nous aider à vivre en enfants de Dieu appelés à la liberté, pauvres de tout mais riches du Christ. Retrouvons le chemin de l’intériorité pour écouter la voix de l’hôte intérieur. « Tout ce qu’Il vous dira, faites-le ! », avait conseillé Marie aux serviteurs de la noce. C’est encore son conseil pour nous ce matin.
Amen !
Méditation du père Gilles.
Homélie de Mgr Michel Aupetit, 9 novembre 2025.
Commentaires vidéo complets (4 lectures) de Marie-Noëlle Thabut, bibliste.
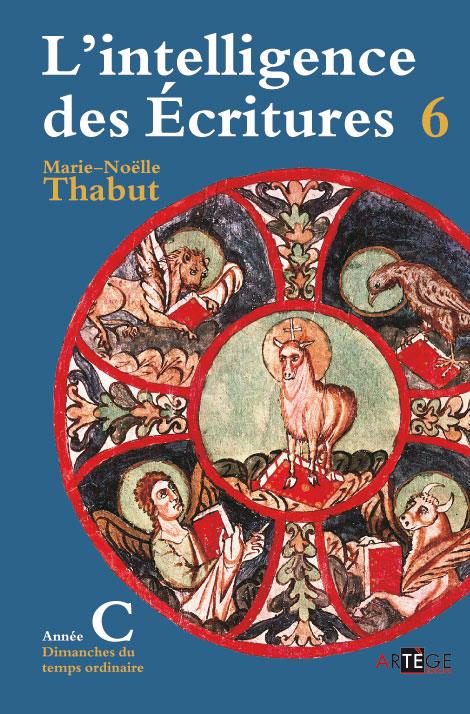

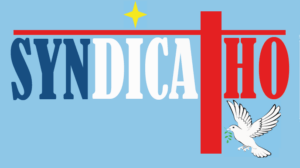
COMMENTAIRES RÉCENTS (5)