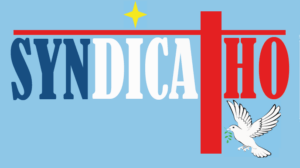« Disparition du pape François : l’Église catholique va-t-elle durablement adopter une position hostile au libre-marché ? », par Jean-Yves Naudet

Le pape François – « Catch the flag » (« Attrape le fanion »). Photo de _Franck Michel_ sur VisualHunt.com.
Le professeur Jean-Yves Naudet, fondateur et ex-président de l’Association des Économistes Catholiques (AEC) a publié avant-hier, 21 avril 2025, l’article suivant sur le site de l’IREF, après l’annonce du décès du pape François.
La disparition brutale du pape François, le lundi de Pâques, qui était apparu, la veille, très fatigué, après une longue hospitalisation, a entraîné beaucoup d’émotion dans le monde catholique et au-delà. Certains ont parlé d’un pontificat de rupture. C’est l’occasion de revenir sur sa conception de la doctrine sociale de l’Église. On connait les prises de positions fréquentes de François contre le capitalisme. Mais, au-delà des discours de circonstances, François a-t-il fait évoluer les grands principes de la doctrine sociale dans un sens hostile au libre-marché ?
Les papes Jean-Paul II et Benoît XVI avaient, dans leurs encycliques sociales, défendu les grands principe de l’économie de marché : propriété, subsidiarité, liberté économique…Ces papes avaient connu les totalitarismes, notamment communiste, et pris clairement position pour les libertés en général et les libertés économiques en particulier. Le pape François, qui vient de disparaitre, a semblé tourner le dos à ces analyses et a multiplié les discours hostiles au capitalisme, au profit et au libre-marché, probablement influencé par l’histoire de son pays, du capitalisme de connivence et de l’héritage du péronisme.
Mais ce qui compte, ce ne sont pas les discours de circonstances, qui reflètent la « sensibilité » de chaque pape, mais les grands principes de la doctrine sociale de l’Église. Or, au moins sur deux de ces principes, la propriété et la subsidiarité, François a semblé infléchir fortement la doctrine sociale dans un sens hostile au libre-marché.
En ce qui concerne la propriété privée, elle a toujours été défendue par l’Église. Thomas d’Aquin la défendait, comme conforme au droit naturel. Les papes successifs, depuis Léon XIII font de même. Ce dernier, dans Rerum novarum (1891) a affirmé à son tour que la propriété privée était de droit naturel, a condamné la « proposition funeste » des socialistes de supprimer la propriété, et il a déclaré « Que ceci soit donc bien établi : le premier principe sur lequel doit se baser le relèvement des classes inférieures est l’inviolabilité de la propriété privée. » (RN § 12-2). Il a aussi expliqué comment concilier la propriété privée et le fait que tous les hommes aient droit à accéder aux biens (« destination universelle des biens ») : la propriété favorise cette destination, car elle est source de revenus (revenus de l’entrepreneur, du capital et du travail) et ces revenus permettent d’accéder aux biens. Si cela ne suffit pas, la solidarité complètera, si nécessaire. Tous les papes ont été sur cette ligne.
Or François a semblé infléchir ces principes. Dans son encyclique Fratelli tutti, le pape François aborde la question de la propriété : « Je rappelle que la tradition chrétienne n’a jamais reconnu comme absolu ou intouchable le droit à la propriété privée, et elle a souligné la fonction sociale de toute forme de propriété privée. Le principe de l’usage commun des biens créés pour tous est le premier principe de tout l’ordre éthico-social ; c’est un droit naturel, originaire et prioritaire. Tous les autres droits concernant les biens nécessaires à l’épanouissement intégral des personnes, y compris celui de la propriété privée et tout autre droit n’en doivent donc pas entraver, mais bien au contraire faciliter la réalisation (…). Le droit à la propriété privée ne peut être considéré que comme un droit naturel secondaire et dérivé du principe de la destination universelle des biens créés ; et cela comporte des conséquences très concrètes qui doivent se refléter sur le fonctionnement de la société. Mais il arrive souvent que les droits secondaires se superposent aux droits prioritaires et originaires en les privant de toute portée pratique » (§ 120). universelle des biens. C’est important, car un droit naturel secondaire n’est plus véritablement un droit naturel, ce qui, si on pousse le raisonnement plus loin, remet en cause le principe même de la propriété privée.
Deuxième exemple, la subsidiarité ; principe essentiel depuis Pie XI. Les décisions doivent se prendre au plus bas niveau possible, celui des personnes, des familles, des associations, des entreprises, et ne faire appel à l’échelon supérieur, et en dernier ressort à l’État, qu’en cas d’impossibilité. C’est le fondement de toutes les libertés, notamment économiques, et donc du libre marché. Pour Benoît XVI, la subsidiarité est « l’expression de l’inaliénable liberté humaine » (Caritas in veritate § 52).
À sa façon, le pape François, dans Fratelli tutti, rend hommage à cette action subsidiaire de la société : « Grâce à Dieu, beaucoup de regroupements et d’organisations de la société civile aident à pallier les faiblesses de la Communauté Internationale, son manque de coordination dans des situations complexes, son manque de vigilance en ce qui concerne les droits humains fondamentaux et les situations très critiques de certains groupes. Ainsi, le principe de subsidiarité devient une réalité concrète garantissant la participation et l’action des communautés et des organisations de rang inférieur qui complètent l’action de l’État ». (§ 175).
En réalité, sous couvert d’une apparente défense de la subsidiarité, François inverse radicalement le principe. Si on lit bien ce texte, c’est l’action des États qui est première et la société civile est là pour pallier les insuffisances de l’action étatique ; elle n’est plus qu’un complément, au lieu d’être première (On trouve la même dérive dans l’application de la subsidiarité dans les traités européens). Le principe est donc dénaturé ; pour François, c’est l’État qui est premier et les organismes décentralisés de la société civile ne font que combler les insuffisances étatiques.
Le pape François n’est plus, un nouveau pape prendra bientôt la suite. Il y a donc là un débat essentiel : l’Église catholique va-t-elle rester fidèle à la tradition de sa doctrine sociale et défendre la propriété, la subsidiarité et les libertés économiques, tout en rappelant — c’est son rôle — les exigences de la morale et de la charité ? Ou va-t-elle s’engager dans la voie ouverte par François et s’éloigner de ces principes fondamentaux ? C’est une question importante pour le combat des libéraux, car il est essentiel d’avoir, autant que possible, l’appui des « autorités morales ». Quant aux catholiques, ils se poseront la question de l’avenir de la doctrine sociale : si un pape dit, durablement et fermement, le contraire de ses prédécesseurs à propos des principes essentiels, c’est qu’on n’est plus dans la doctrine, celle-ci, par définition, étant immuable. François a donné un infléchissement contraire à ses prédécesseurs ; à son successeur de ne pas transformer cet infléchissement en rupture avec les grands principes de la doctrine sociale.